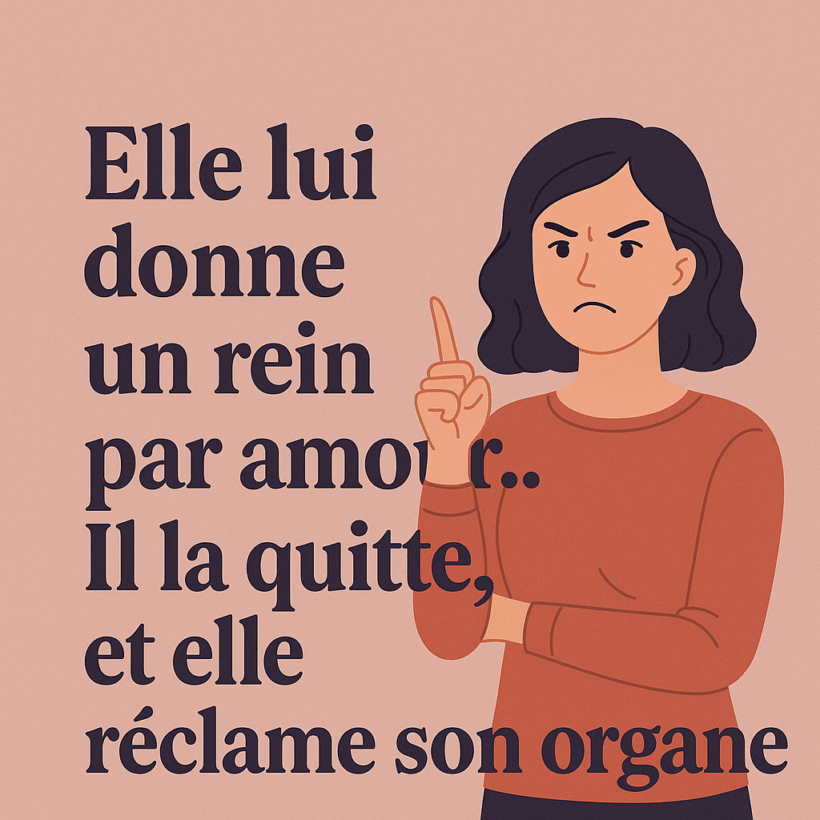C’est une histoire à la fois bouleversante et déroutante, qui suscite autant d’émotion que de questions juridiques et éthiques. Lors d’un épisode de l’émission Legend animée par Guillaume Pley, le professeur Karim Boudjema, éminent chirurgien spécialiste des greffes, est revenu sur une anecdote pour le moins surprenante : celle d’une femme qui, après avoir donné un rein à son mari, a voulu le récupérer… suite à leur séparation.
L’amour donne… et parfois regrette
L’histoire semble sortie d’un scénario de film dramatique. Une femme offre un rein à son époux malade, un geste d’amour pur, un sacrifice immense. Mais une fois remis sur pied, l’homme décide de refaire sa vie… sans elle. C’est le cœur brisé qu’elle réclame ce qu’elle considère encore comme « son rein ».
L’anecdote évoquée par le Pr Boudjema fait écho à un cas bien réel : celui de Samantha Lamb, une Britannique qui a donné un rein à son mari en 2009, avant que celui-ci ne la quitte quelques années plus tard. Dans la presse anglaise, elle exprimait alors son amertume :
« Je le déteste. Si je le pouvais, je retournerais sur la table d’opération et je donnerais le rein à quelqu’un d’autre. »
Une phrase qui en dit long sur la détresse émotionnelle que peut engendrer un tel don… lorsqu’il est mêlé à des liens affectifs.
Peut-on récupérer un organe donné ?
Non. Donner, c’est donner. Reprendre, c’est voler – dit l’adage populaire. Et dans le domaine de la greffe, cela s’applique à la lettre. En France, une greffe ne peut ni être reprise, ni annulée, ni faire l’objet d’un échange ou d’un remboursement. Une fois l’organe greffé, il fait partie intégrante du corps du receveur. Il n’y a aucune voie légale pour revenir sur ce don.
Et pour cause : la loi encadre strictement le don d’organes entre vivants. Environ 9 % des greffes réalisées en France concernent des dons de vivants, principalement pour les reins. Ces dons doivent être :
- Gratuits ;
- Volontaires ;
- Non anonymes ;
- Et motivés par un lien familial ou affectif stable entre donneur et receveur.
Avant toute intervention, le donneur doit passer devant le Président du tribunal judiciaire pour valider son consentement libre et éclairé, et devant un comité donneur vivant, chargé de veiller à l’absence de pression psychologique ou financière.
Et en cas de séparation ou de trahison ?
Aussi douloureuse que soit la rupture, aucun recours n’existe pour réclamer l’organe donné. Ni en France, ni dans la majorité des pays où le don d’organe est encadré par des règles éthiques strictes. Le rein greffé n’est plus un bien que l’on peut « reprendre ». Il est devenu vital pour la survie du receveur.
Ce genre de situation souligne toutefois la fragilité émotionnelle du don entre proches. Comme le rappelle le Pr Boudjema :
« Les greffes entre vivants peuvent poser des problèmes. C’est pourquoi elles sont strictement encadrées, pour éviter les dérives affectives ou financières. »
Un acte d’amour… à ne jamais prendre à la légère
Donner un organe, c’est offrir une seconde chance à quelqu’un qu’on aime. Mais c’est aussi un engagement irrévocable. Le faire en espérant une reconnaissance éternelle ou en pensant que cela préservera un couple est dangereux. Si les sentiments s’effondrent, le geste reste. Et avec lui, parfois, un immense regret.
Alors avant de donner, il faut être sûr. Sûr de ses motivations. Sûr de sa liberté. Et surtout, prêt à accepter que l’amour, lui, n’est jamais garanti.