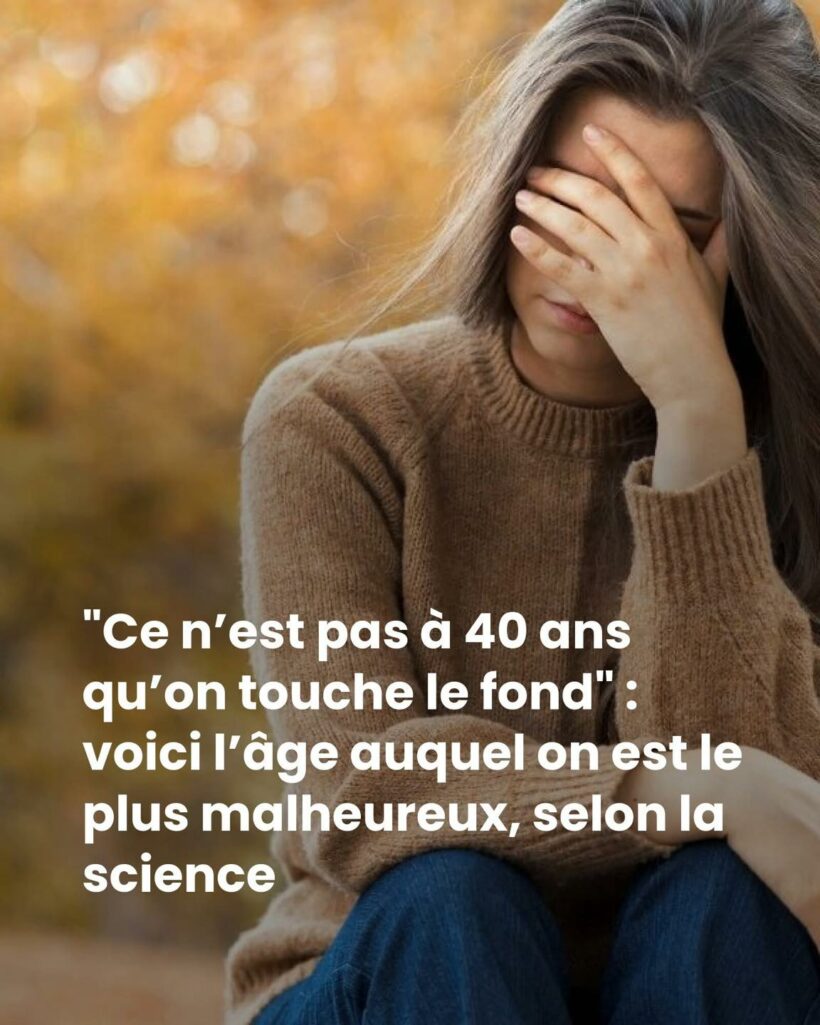On a longtemps cru que le fameux « coup de blues » survenait à la quarantaine, ce passage de vie souvent décrit comme une crise existentielle. Mais une série d’études récentes bousculent cette idée reçue : ce n’est pas à 40 ans que l’on touche le fond, mais bien plus tôt, dès le début de la vingtaine.
Le bonheur ne suit pas une courbe en U
Pendant des années, les chercheurs pensaient que le bien-être suivait une trajectoire en forme de U : heureux enfant, puis progressivement moins satisfait à l’âge adulte, pour enfin retrouver le sourire après 40 ou 50 ans.
Or, une étude publiée dans la revue PLOS One, portant sur plus de 10 millions d’Américains, 40 000 ménages britanniques et près de deux millions de personnes dans 44 pays, raconte une toute autre histoire. Les résultats montrent que la chute de moral est la plus brutale autour de 22 ans, puis diminue progressivement avec l’âge. Autrement dit, plus on vieillit, plus on retrouve une forme de sérénité.
Pourquoi les jeunes sont-ils si malheureux ?
Le professeur David Blanchflower, co-auteur de l’étude, observe une tendance alarmante : le mal-être mental est désormais plus marqué chez les jeunes adultes que chez leurs aînés, et ce phénomène est mondial.
Plusieurs facteurs expliquent cette réalité :
- La crise économique de 2008, qui a fragilisé l’avenir d’une génération entière.
- La pandémie de Covid-19, avec ses confinements, ruptures scolaires et incertitudes professionnelles.
- L’usage massif des réseaux sociaux, source d’anxiété, de comparaison permanente et parfois d’isolement.
Résultat : un quart des jeunes âgés de 15 à 29 ans souffrent de dépression, selon une enquête menée par la Mutualité française, l’Institut Montaigne et l’Institut Terram.
Les générations plus âgées, plus heureuses
À l’inverse, les baby-boomers affichent les niveaux de satisfaction les plus élevés, avec plus de 75 % se déclarant heureux. Contrairement aux clichés, le bonheur semble donc davantage lié à l’expérience, à la stabilité et au recul que l’on acquiert en vieillissant.
Un constat inquiétant, mais porteur d’espoir
Ces résultats interpellent : comment une génération censée être à l’âge des possibles peut-elle sombrer si tôt dans le désespoir ? La réponse n’est pas simple, mais une chose est claire : le mal-être n’est pas une fatalité. Plus que jamais, il est essentiel de parler de santé mentale, d’accompagner les jeunes et de repenser nos modèles sociaux, éducatifs et économiques.
Car si le creux du moral se situe autour de 22 ans, la bonne nouvelle est que, selon la science, la vie devient progressivement plus légère et plus heureuse au fil des années.